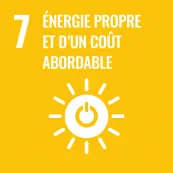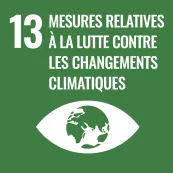Découvrez l'interview de Frédéric Coupain (IDEA) sur l'échelle de performance CO2, utilisée comme outil pour des achats publics plus durables dans le secteur des eaux usées.
des Wallon.ne.s sont domicilié.e.s à proximité piétonne d'un arrêt de transports publics
des Wallon.ne.s vivent dans un logement présentant un problème d'humidité (2022)
de diminution des émissions de particules fines (2021)
Objectifs prioritaires de la Wallonie
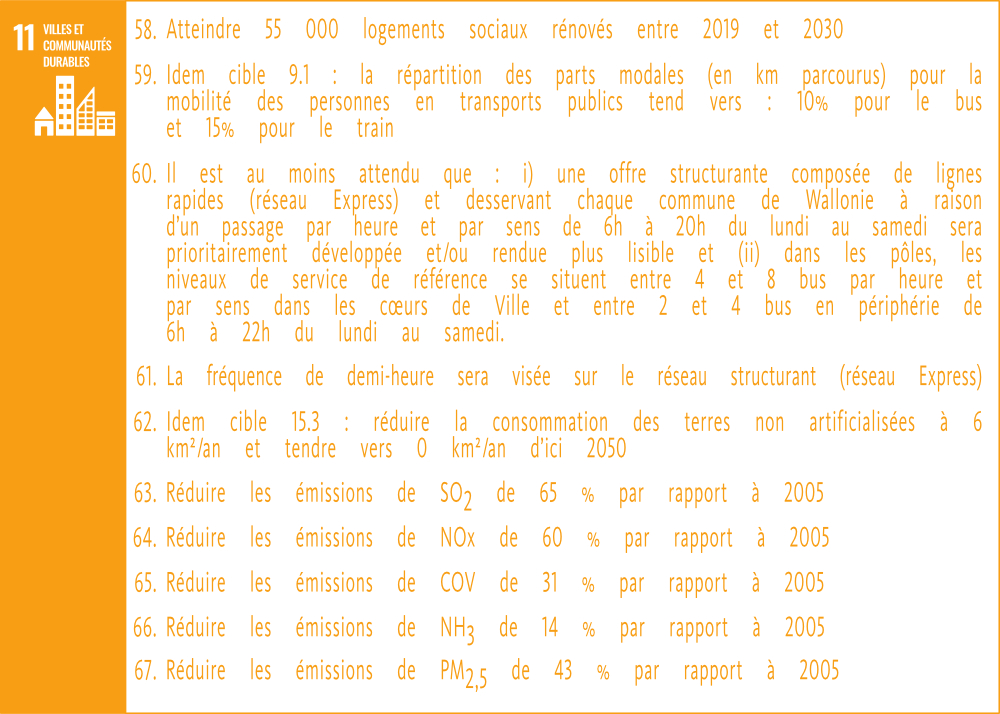
- Quelle est l'évolution des indicateurs de suivi ?
Les progrès vers cet objectif en Wallonie, région rurale et urbaine, sont liés à l’aménagement du territoire et à la qualité des lieux de vie.
Les terrains artificialisés, c’est-à-dire les surfaces retirées de leur état naturel, représentaient en 2022 entre 11 et 16 % du territoire wallon, avec une croissance moyenne de 16 km² par an depuis 1985. L’artificialisation du territoire s’explique essentiellement par l’expansion des terrains résidentiels, au détriment des terres agricoles. En 2022, 13 km² avaient été artificialisés. Au total, sur la période 2002-2022, on observe un éloignement modéré de l’indicateur par rapport à l’objectif wallon de réduire la consommation des terres non artificialisées à 6 km²/an d’ici à 2030 et de tendre vers 0 km² /an d’ici à 2050.
Par ailleurs, la superficie résidentielle par habitant est en constante augmentation, provoquant un phénomène de « desserrement » (à l’opposé de la densification). Cette évolution montre un éloignement modéré par rapport à l’ODD. Il existe cependant de fortes disparités entre les communes wallonnes, certaines allant vers une densification alors qu’une grande partie du territoire, surtout au Sud de la Wallonie, montre une tendance au desserrement du résidentiel. La croissance de la superficie résidentielle a quand même tendance à ralentir ces dernières années par rapport aux décennies précédentes, grâce à des modes de production de l’habitat progressivement plus parcimonieux du sol. En 2022, chaque habitant consommait en moyenne 305 m² pour son habitat (logement, jardin, cour, garage, etc.).
Au niveau de la mobilité, environ 60% des Wallon.ne.s sont domicilé.e.s à proximité piétonne d’un arrêt de transports publics (train et bus) bien desservi. De fortes disparités existent au sein du territoire wallon, avec des zones nettement moins desservies. Cette accessibilité est déterminante pour augmenter la part de la mobilité des personnes assurée par les transports publics (cf. ODD 9).
L’accès à un logement de qualité fait partie des besoins essentiels pour toutes et tous.
Environ un.e Wallon.ne sur six (17,4 % en 2022) vit dans un logement qui présente, au minimum, un problème d’humidité. Cela n’est pas sans impact pour la santé des habitant.e.s (cf. ODD 3) et la consommation énergétique (cf. ODD 7). Au niveau des logements publics disponibles en Wallonie, sur un parc de 101 000 logements, 20 649 logements ont été rénovés sur les années 2019 à 2022. Ceci constitue un progrès significatif par rapport à l’objectif wallon d’avoir rénové 55 000 logements publics d’ici à 2030.
Quant à la pollution atmosphérique, phénomène particulièrement problématique dans les villes, les émissions de particules fines (PM2,5) ont fortement diminué sur la période 2000-2021 (-63 %) grâce à une diminution des émissions issues des secteurs de l’énergie, de l’industrie, du transport et du secteur résidentiel. L’objectif de diminuer les émissions de particules PM2,5 de 43 % d’ici à 2030 par rapport à 2005, était déjà respecté en 2021. Cependant, la réduction des émissions doit être poursuivie et les efforts maintenus pour tendre vers les nouvelles valeurs-guides plus strictes de l’OMS, car les niveaux actuels sont jugés insuffisants pour protéger la santé (cf. aussi ODD 3). Les émissions de polluants acidifiants (oxydes d’azote, ammoniac et dioxyde de soufre) n’ont cessé de diminuer sur les vingt dernières années et les objectifs fixés à l’horizon 2030 sont atteints également. La réduction de ces émissions reste toutefois un enjeu pour la Wallonie étant donné leur rôle dans la formation de particules fines (PM2,5) nocives pour la santé humaine. Il en est de même pour les composés organiques volatiles.
Pour en savoir plus, consultez les indicateurs de l'IWEPS et le bilan des progrès complet.
- Quels sont les plans et les stratégies en lien avec cet Objectif en Wallonie ?
- Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat permanent dans les équipements touristiques (HP) (2021)
- Plan de rénovation pour 55 000 logements publics (2022)
- Plan global Wallonie cyclable 2030 (2022)
- Plan horizon proximité - Soutien à la redynamisation des centralités et des commerces (2021)
- Plan mobilité et infrastructures pour tous (2020)
- Schéma de développement du territoire (SDT) (2019)
- Stratégie régionale de mobilité des personnes (2019)
- Alliance climat emploi rénovation (ACER) (2022
- Alternativ’ES Wallonia – Stratégie de la Wallonie pour soutenir le développement de l’économie sociale (2020)
- Plan air climat énergie 2030 (PACE) (en préparation)
- Plan de lutte contre les discriminations dans l’accès au logement (2020)
- Plan de cohésion sociale des villes et des communes (PCS) (2019)
- Plan de relance de la Wallonie (2021)
- Plan genre (2020)
- Plan wallon de sortie de la pauvreté (2021)
- Plan wallon des déchets - ressources (2018)
- Plan wallon environnement-santé (ENVIeS) (2019)
- Plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) (2021)
- Programme wallon de développement rural (2022)
- Stratégie intégrale sécheresse (2021)
- Stratégie wallonne de développement durable (2022)
- Stratégie wallonne de politique répressive environnementale (2021)
- Stratégie wallonne de rénovation énergétique à long terme du bâtiment (2020)
- Quelle est la situation à l'échelle internationale ?
Plus de la moitié de la population mondiale réside actuellement dans des zones urbaines et ce taux devrait atteindre 70 % d’ici à 2050. Environ 1,1 milliard de personnes vivent actuellement dans des taudis ou dans des conditions semblables dans les villes et on devrait en compter 2 milliards de plus dans les 30 prochaines années.
En savoir plus sur les cibles définies à l'échelle internationale et les chiffres clés.